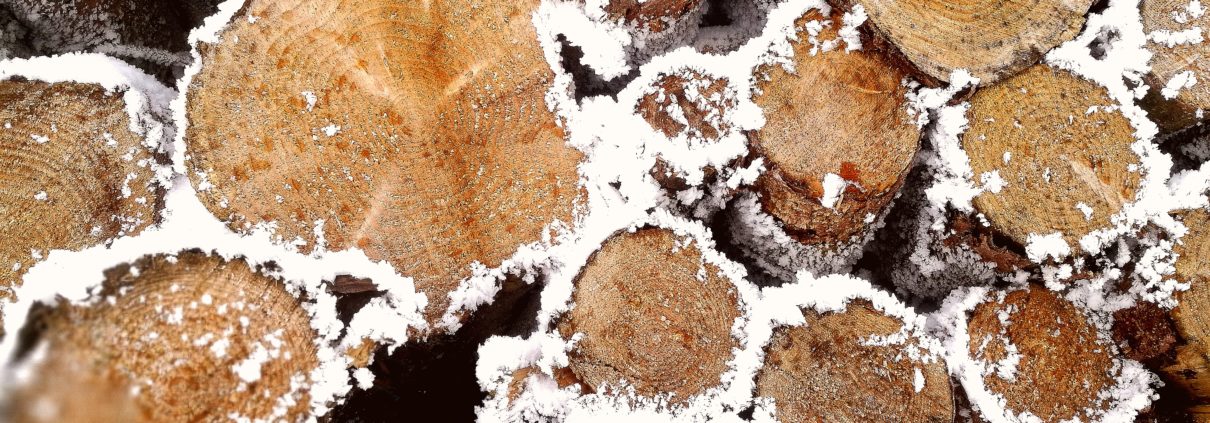Le 13 avril dernier, une chambre mixte de la Cour de cassation a été réunie aux fins d’opérer un revirement en matière de contrat de crédit-bail. C’est plus particulièrement le devenir du contrat liant la banque au crédit-preneur, à la suite de la disparition du contrat de vente qui a été examiné. La Cour de cassation considère ainsi que l’anéantissement du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération. Elle vient par la présente décision infléchir la position qu’elle retenait jusqu’alors et aligner, sur ce point, les régimes de la location financière et du crédit-bail.
Le rappel des faits
Le rappel des faits de l’espèce permet de mieux cerner ce contrat sui generis qu’est le crédit-bail.
Une société a conclu le 10 mai 2010 (le droit applicable est donc celui antérieur à la réforme du droit des contrats de 2016), un contrat dans lequel le vendeur s’engageait à fournir un camion équipé d’un plateau et d’une grue. Il était prévu que la charge utile restante du véhicule devait être de huit cent cinquante kilogrammes au minimum. Afin de financer l’acquisition de ce véhicule, la société a conclu, le 3 juin 2010, avec une banque, un contrat de crédit-bail mobilier. A première vue, le contrat de vente est bien exécuté puisque le camion est livré accompagné de sa carte grise et d’un procès-verbal de contrôle de conformité initial. Pourtant, à la suite d’un contrôle de police, un défaut de conformité apparaît : le poids à vide du véhicule est en réalité supérieur à celui indiqué sur le certificat d’immatriculation et la charge disponible inférieure à celle contractuellement prévue. Par conséquent, le crédit-preneur assigne le vendeur et la banque en nullité de la vente et du crédit-bail.
Devant la Cour de cassation, deux pourvois sont formés. Le premier (n° H 16-21.345), formé par le vendeur et la banque, repose sur la contestation du prononcé de la résolution de la vente pour défaut de conformité par les juges du fond. C’est le second pourvoi (n° M 16-21.947), formé par le banque, qui retiendra ici notre attention en ce qu’il conteste le prononcé de la caducité du contrat de crédit-bail mobilier, caducité consécutive à la résolution du contrat de vente.
Le crédit bail n’est pas une location financière : le rappel d’une distinction fondée sur le transfert de propriété
A travers la présente espèce, apparaît la distinction classique entre le crédit-bail et la location financière.
Le contrat de crédit-bail mobilier est prévu à l’article L. 313-7 du code monétaire et financier. Il s’agit d’un contrat de louage d’un matériel professionnel, qui permet au preneur de jouir du bien. En contrepartie de cette jouissance, un loyer est payé. La particularité du crédit-bail est qu’il s’accompagne d’une promesse unilatérale de vente, qui confère au crédit-preneur la possibilité de lever une option d’achat en fin de contrat.
Au contraire, la location financière ne permet pas d’acquérir la propriété du bien, ce qui constitue une distinction majeure entre ces deux contrats.
C’est cette distinction que l’on peut lire en creux dans la décision de la haute juridiction, lorsqu’elle précise que la jurisprudence concernant la location financière n’est pas transposable « au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente ».
Mais la solution retenue en matière de location financière doit être étendue au crédit bail : la caducité du contrat liant le crédit bailleur au banquier ensuite de la résolution de la vente
Pour autant, si la jurisprudence n’est pas transposable, la Cour de cassation décide, à travers cette décision, de réduire la distinction entre le crédit-bail et la location financière, situations contractuelles marquées par l’imbrication de différents contrats.
En effet, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération financière commune peuvent être considérés comme interdépendants. Dès lors, la Cour de cassation a considéré à plusieurs reprises que l’anéantissement de l’un quelconque de ces contrats entraine la caducité de l’autre (en ce sens Com., 12 juillet 2017, n° 15-27.703, publié). La caducité vient ici sanctionner une disparition de la cause en cours d’exécution du contrat.
Au contraire, concernant le contrat de crédit-bail, à plusieurs reprises, la Cour se montrait plus sévère à l’encontre du crédit-preneur puisqu’elle considérait que seule la résiliation du contrat pouvait être prononcée en cas d’anéantissement du contrat de vente. (en ce sens Ch. mixte., 23 novembre 1990, n° 86-19.396, n° 88-16.883 et n° 87-17.044, B. 1 et 2 ; Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, B. 327 ; Com., 28 janvier 2003, n° 01-00.330 ; Com., 14 décembre 2010, n° 09-15.992 ).
Comme le rappelle la Haute juridiction dans cette décision – poursuivant ainsi un objectif de motivation et de pédagogie à travers la rédaction de ses décisions – cette résiliation du contrat conduisait alors à l’application « de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ».
Une évolution du crédit-bail dans le sens de la réforme du droit commun des contrats
L’écart entre le contrat de crédit-bail et la location financière devenait difficilement justifiable, et ce plus particulièrement au regard de la réforme du droit des contrats. Bien que les textes nouveaux ne furent pas applicables en l’espèce, la haute juridiction a très certainement pu se laisser guider par eux afin d’opérer ce revirement.
En effet, depuis l’ordonnance de 2016, ce n’est plus une lecture détournée de la cause qui sert de fondement au prononcé de la caducité du contrat interdépendant, mais un texte, l’article 1186 du code civil qui dispose :
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.